
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Robert Smithson et la notion de dislocation | |
|
"La terre, pour moi, n'est pas la nature, mais un musée" R.S. | |
 Robert Smithson, Non-Site, Line of Wreckage, New Jersey, 1968. Courtesy John Weber Gallery, New York. |
D
ans les écrits de Robert Smithson, dislocation et décentrement
deviennent les pôles autour desquels de tisse toute une philosophie
de l'art en relation étroite avec l'état des territoires
contemporains. Ces deux notions semblent effectivement tout à fait représentatives de l'esprit de l'époque, dominé par l'impulsion révolutionnaire et les initiatives en marge du pouvoir institutionnel. Mais à la base, c'est le spectacle d'une urbanisation américaine massive et éclatée qui amène Robert Smithson à développer sa théorie. Il voit dans la manière dont prolifèrent les banlieues et s'industrialisent les paysages la manifestation concrète du renversement radical de nos conceptions traditionnelles de l'espace-temps, jusqu'alors basées sur un sentiment de linéarité et de centralité. |
| Ses
réflexions sur le territoire seront largement inspirées
d'un entretien de l'artiste Tony Smith avec Samuel Wagstaff, publié
dans le revue Artforum en 1966. Dans cet entretien, Tony Smith
expliquait comment une promenade en voiture faite au début des
années 50 sur un échangeur autoroutier du New Jersey avait
agi sur lui comme un "révélateur d'expérience artistique".
Ce qui fascine Robert Smithson dans la description de Tony Smith,
c'est que le paysage devient une espèce de phrase ponctuée.
C'est-à-dire un paysage semé d'interruptions que seule la
route, la traversée de la route, vient unifier : "Tony Smith
parle d'une chaussée sombre qui est ponctuée par des cheminées
d'usine, des tours, des fumées et des lumières multicolores
[...] En un sens, on peut considérer la chaussée sombre
comme une longue phrase, et les choses que l'on y perçoit en
la parcourant comme des signes de ponctuation : les tours = les points d'exclamation (!), les cheminées = des tirets (-), les fumées = des points d'interrogation (?), les lumières multicolores = les deux points (:). (1) Cette "perception syntaxique" du territoire amène Robert Smithson vers ce raisonnement : non seulement l'art est artificiel, mais aussi toute notre perception de la nature et du monde. Décrivant, à la manière de Tony Smith, l'une de ses promenades dans les banlieues du New Jersey, il fera de la ville banale de Passaic l'emblème de l'artificialité et de la condition entropique des espaces contemporains. Car la configuration de cette ville semble tourner autour de vides urbains. Comme une phrase dépourvue de verbe, Passaic lui semble dépourvue de centre : "Quand au centre de Passaic, ce n'était pas un centre, c'était plutôt un gouffre typique ou un vide ordinaire". Autrement dit, un interminable adjectif sans verbe ni nom : "chaque magasin devenant l'adjectif du suivant, une chaîne d'adjectifs déguisés en magasins." (2) Il découvre, à travers ce délabrement urbanistique, toute une série d'objets industriels, sans histoire ni tradition, qu'il décide d'élever au rang d'oeuvre d'art. Ainsi les reliquats d'installations industrielles deviennent des monuments : "le monument-pont", "le monument à pontons", "le monument- grandes canalisations", "le monument-fontaine", "le monument- bac-à-sable". Le pont pivotant devient quant à lui "le monument des directions disloquées", il commémore l'espace désorienté qu'offre le paysage, où plus aucun repère ne semble organiser l'espace. Confronté à l'aspect disloqué de Passaic, Robert Smithson sera amené à parler de paysage entropique. Car "au lieu d'entretenir le souvenir du passé comme les monuments traditionnels, les nouveaux monuments nous entraînent à oublier le futur. Au lieu d'être construits avec des matériaux naturels, comme le marbre, le granite et d'autres types de roches, les nouveaux monuments sont fabriqués de matériaux artificiels, de plastique, de chrome et d'éclairage électrique. Ils ne sont pas construits pour l'histoire, mais contre l'histoire." (3). Ainsi témoignent-ils de la nouvelle absence de sens du territoire, qui semble se construire tout en se décomposant, qui est devenu un espace d'éternelle périphérie, éclaté et excentré, où ne subsiste aucune mémoire culturelle. Passaic a-t-elle remplacé Rome comme cité éternelle ?, Avec cette question, Robert Smithson pose celle de la défaillance manifeste d'un certain sens historique et culturel. Celui, en l'occurence, du modèle européen, qui avait su construire et imposer une vision égocentrique de l'être humain et de la nature. À l'affirmation de Pascal, expliquant que "la nature est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part", Smithson qualifiera le monde contemporain de "sphère infinie où la circonférence est partout et le centre nulle part". Car aujourd'hui, explique-t-il, le dimensionnel a perdu de son pouvoir d'autrefois. Sites et territoires sont devenus des panoramas zéro, où il n'y a ni noyau, ni centre. Le fait d'être toujours situé entre deux points nous place dans une position d'ailleurs. Il n'y a donc plus de point focal. La limite externe et le centre se confondent constamment, et s'annulent l'un l'autre. Ainsi la désintégration de l'espace comme du temps deviennent-ils manifestes. Dans sa production artistique, il concrétisera cette idée. La notion de SITE servira à évoquer le monde extérieur, dans sa vastitude et sa continuité ; tandis que le NON-SITE en désignera la mise en forme artistique. |
|
| (1)Robert Smithson, "Toward the Development of an Air Terminal Site (1967),
Robert Smithson : The Collected Writings, traduction française
In Gilles A. Tiberghien, Land Art, Paris, Carré,
1995, p.90. (2) Robert Smithson, "A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967)", Robert Smithson : The Collected Writings, traduction française In Gilles A. Tiberghien, op. cit., p.105. (3) Robert Smithson, "Entropy and the New Monuments (1966)", Robert Smithson : The Collected Writings, p. 11-13. Traduit par mes soins. | |
 | 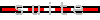 |
| Les territoires inoccupés. http://territoiresinoccupes.free.fr/ | |